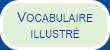Montréal - Collégiale Notre-Dame
(89)
(cliquer
sur
une
image pour
revenir
en haut de la page)


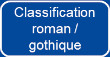




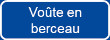






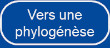





|
Anséric V(*), de la puissante famille seigneuriale de Montréal, entreprit la construction de l’église que nous voyons aujourd’hui, dans la deuxième moitié du XIIème siècle, son fils Anséric VI(*) acheva la construction au début du XIIIème siècle. (*) Selon l’historien François Salet
Cet édifice illustre la transition du roman vers le gothique : une nef voûtée en ogive, des collatéraux couverts en voutes d’arête et un extérieur d’allure romane, aux murs soutenus par d’épais contreforts et percés de petite fenêtres en plein cintre. La simplicité épaisse et frugale de l’extérieur contraste avec la sobriété raffinée de l’intérieur. Le style est sévère mais d’une grande pureté. Le plan ne contient que des formes droites. Les chapiteaux sont ornés de sculptures simples mais avec beaucoup de variations, les profils des moulures sont d’une netteté remarquable et leur exécution est soignée et parfaite. L’église a été édifiée en deux campagnes. Le chœur, le transept et la première travée de la nef ont été réalisés vraisemblablement entre 1170 et 1180. Les deux dernières travées de la nef et la façade sont du début du XIIIème siècle. Le changement de campagne se remarque par la différence de moulure des arcs doubleaux et l’orientation des colonnettes supportant les ogives entre les deux premières travées et la travée orientale. Au revers de la façade une vaste tribune, unique en son genre, est soutenue par de belles consoles en encorbellement et une gracieuse colonne de pierre placée au milieu. Pouvant accueillir entre 20 et 25 personnes, elle servait peut-être de chapelle privée pour les seigneurs de Montréal dont le château, aujourd’hui détruit, était à proximité. La façade adopte un curieux style d’inspiration avec ses deux portes festonnées d’allure mauresque, peut-être une inspiration orientale rapportée par Anséric III au retour de la deuxième croisade. Il avait fait le vœu de construire une église s’il en revenait vivant.
Au XVIème siècle de riches stalles harmonieusement sculptées furent installées dans le chœur (non documentées dans le reportage qui suit). A la révolution l’église fut transformée en temple de la raison. Le bas relief du tympan du portail ouest fut détruit et remplacé par des slogans révolutionnaires. L’église fut classée aux monuments historiques en 1846. Dans un grand état de fatigue car fragilisée par des infiltrations souterraines, elle fut restaurée de 1845 à 1852 par Eugène Viollet-le-Duc qui œuvrait alors à Vézelay. Les charpentes et la couverture furent refaites, les contreforts latéraux furent renforcés, des arcs-boutants furent placés dans les combles des collatéraux pour renforcer la structure de l’édifice. Trois voûtes des collatéraux furent refaites et les fenêtres hautes de la nef furent réouvertes. Cette belle église se remarque par l’absence de clocher. En fait un clocher aurait été construit à la croisée du transept bien après l’achèvement de l’édifice alors que la structure nécessaire n’avait pas été prévu par les bâtisseurs à l’origine. Détruit par une tempête, il fut remplacé au XIIIème siècle par un clocher renaissance lui aussi remplacé au début du XIXème siècle par une sorte de flèche qualifiée de pigeonnier par Viollet-le-Duc qui le démonta lors de la restauration. |


Le pigeonnier dessiné par Viollet-le-Duc dans les annales archéologique (1847 et 1851)
| Je
vous
suggère de visiter Le Site sur l’Art Roman en Bourgogne (www.bourgogneromane.com)
qui
est
une véritable encyclopédie, un centre documentaire
exhaustif proposant une incroyable richesse d’informations
sur l’art roman en général et plus particulièrement sur
son développement en Bourgogne.
Dans la page consacrée à l'église de Montréal vous trouverez le contexte historique et culturel ainsi que la description détaillée de l’architecture et de la sculpture. |


Vue générale (source www.annuaire-mairie.fr)
Vue générale (source www.youtube.com)












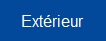




























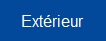








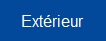








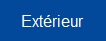














































|
Dimensions Longueur totale : environ 35 m. Largeur : environ 17 m. |