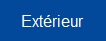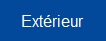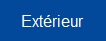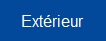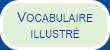Poitiers - Eglise Sainte Radegonde
(86)
(cliquer
sur
une
image pour
revenir
en haut de la page)


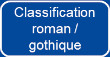




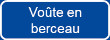






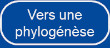




|
L’église Sainte Radegonde à Poitiers a une longue histoire depuis le VIème siècle où elle fut érigée par Radegonde, reine des Francs, épouse de Clotaire 1er. De l’église reconstruite au début du XIème siècle, en 1012, il ne reste que la crypte dont les abords et l’accès ont été malheureusement défigurée par de maladroites restaurations au XVème et au XIXème siècle. La crypte, aux trois quart enterrée, comporte une travée droite et une abside semi-circulaire entourée d’une galerie ouvrant sur trois chapelles rayonnantes. La nouvelle église fut ravagée par un incendie en 1083. Rapidement reconstruit le nouvel édifice fut consacré en 1099. De cet édifice il subsiste le chœur et les parties basses du clocher porche. Le chœur, soutenu par les structures de la crypte, est typiquement roman. Une abside en cul de four précédée d’une travée droite est entourée d’une déambulatoire couvert de voûtes d’arêtes ouvrant sur trois chapelles rayonnantes. Les chapiteaux du déambulatoire sont historiés et les voûtes peintes. L’ensemble mériterait d’être restauré pour enrayer l’état de décrépitude vers lequel il s’enfonce. Les parties basses du clocher-porche, qui forent une sorte de nathex à l’allure très sévère, datent de la fin du XIème siècle. Les parties hautes sont de la première moitié du XIIème siècle. Un escalier permet de communiquer avec la nef du XIIIème siècle construite à un niveau plus bas. Dans la première moitié du XIIIème siècle une nef gothique est construite entre le chœur et le clocher porche romans. On ignore s’il s’agit du remplacement d’une nef romane dont on ignore tout ou s’il s’agit de la reprise des travaux interrompus pendant un siècle après la consécration de 1099. La nef de quatre travées a fait l’objet de deux campagnes, la première au début du siècle pour les deux premières travées orientales et la moitié de la troisième travée, la deuxième à la fin du siècle pour l’autre moitié de la troisième et la quatrième travée. Large de 13 mètres, elle est voûtée en ogives de type angevin comme à Angers (49), c’est-à-dire très bombées, presque comme des coupoles, renforcées par de fines ogives complétées par des liernes. La très nette différence entre les dimension des contreforts extérieurs de la première et de la deuxième campagne illustre l’évolution dans la maîtrise de l’art de construire au juste nécessaire.Au XVème siècle le sol du déambulatoire fut abaissé pour le mettre de plain-pied avec la nef et l’accès primitif à la crypte par deux petits escaliers latéraux fut remplacé par un escalier central plongeant vers le sanctuaire abritant les reliques. Un portail flamboyant fut accolé au portail du clocher-porche. Des restaurations maladroites furent entreprises au XIXème siècle, notamment dans la crypte et l’escalier d’accès. |







Cathédrale Saint Pierre Église Sainte Radegonde