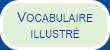SAINT-GILLES du GARD - Abbaye
Saint-Gilles (30)
(cliquer
sur
une
image pour
revenir
en haut de la page)


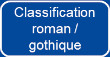




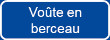






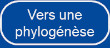





|
Située à une quinzaine de kilomètres à l’est d’Arles et à proximité des étangs de Camargue, Saint Gilles du Gard fut une cité portuaire dès l’Antiquité. Un monastère y fut fondé au VIIIème siècle où vint se retirer un moine ermite, Saint Gilles, vénéré pour les miracles qu’il accomplissait.
Devenue le quatrième lieu de pèlerinage au Moyen Âge, derrière Jérusalem, Rome et Saint-Jacques de Compostelle, la cité était un haut lieu de rendez-vous des pèlerins qui se rendaient en Terre Sainte ou à Rome et venaient adorer les reliques de Saint Gilles. La cité prospérait économiquement, notamment grâce à son port de commerce, et il devenait nécessaire de la doter d’une église plus vaste et plus majestueuse que les deux églises d’alors. C’est au début du XIIème siècle que fut entreprise la construction de l’église dont nous voyons aujourd’hui ce qu’il en reste.
Bien que classée au patrimoine mondial de l’UNESCO en 1998 au titre des chemines de Saint-Jacques de Compostelle en France, l’abbatiale reste méconnue proportionnellement à l’abondante littérature qui lui est consacrée et aux nombreux programmes de recherches dont elle fait encore l’objet.
L’église
projetée
au XIIème
siècle comprenait une vaste crypte, appelée aussi église
basse, presqu’aussi grande que la nef de l’église
supérieure, une nef de six travées bordée de deux
collatéraux, un transept non-saillant et un vaste chœur
à déambulatoire avec cinq chapelles rayonnantes, un
imposant clocher et une majestueuse façade occidentale
richement sculptée. De cet imposant édifice roman, qui
vécut bien des malheurs tout au long de son existence,
il ne reste que la façade, la crypte, les parties
inférieures jusqu’à la naissance des arcades de l’église
haute, les ruines des soubassements du chœur et les
restes d’une tour, à l’extrémité nord de l’abside, qui
abritait un escalier hélicoïdal menant à des tribunes,
la célèbre vis de Saint-Gilles.
Histoire de la construction L’édification de l’abbatiale Saint Gilles commence en 1116 par les fondations et l’aménagement de la crypte, ou le réaménagement de vestiges souterrains plus anciens pouvant remonter au début du XIème siècle. La façade aurait été construite de 1120 à 1160, la crypte jusqu’en 1140 et même au-delà à cause de multiples réaménagements au fur et à mesure de la construction de la nef bâtie de 1150 à 1175. Le chœur aurait été achevé au début du XIIIème siècle vers 1210. Le clocher commencé en 1157 ne fut achevé qu’au début du XIVème siècle. Les ruines du chœur que l’on voit aujourd’hui donnent une idée de ce que devait être l’abbatiale du XIIème siècle. Un tel étalement de la construction, presque un siècle, résulte d’une part de l’extrême ambition du programme et d’autre part des nombreuses interruptions dues aux conflits entre les bénédictins qui avaient autorité sur l’abbatiale rattachée à Cluny en 1077 et les moines de l’abbaye.
Histoire de la destruction Après cette longue gestation l’abbatiale fut dévastée par les Huguenots en 1562. L’abbatiale est incendiée et les voûtes de la nef s’effondrent, le clocher découronné, la bibliothèque et les archives détruites et bien d’autres mutilations sont infligées aux bâtiments monastiques. Une partie des reliques sont sauvegardée dans la basilique Saint-Sernin de Toulouse. En 1622 le duc de Rochan, alors chef des protestants, ordonne la destruction totale de l’abbaye. La partie haute de la façade disparaît, la façade est ébranlée par des explosions, le clocher est abattu et le chœur ruiné. Fort heureusement les troupes protestantes quittent l’abbaye après la victoire de Louis XIII sur les huguenots à Montpellier.
Les restaurations de l’abbatiale D’importants travaux de restauration, entrepris entre 1660 et 1655, transformèrent radicalement l’édifice. Seules les six premières travées de la nef furent conservées jusqu’au niveau des grandes arcades. On reconstruisit les grandes arcades des cinq premières travées que l’on couvrit de voûtes en ogive, on aménagea un chœur pentagonal dans la sixième travée, entouré de deux espaces couverts d’ogives. L’ensemble est fortement rabaissé : la nef passe de 26 mètres de haut à 15 mètres et les collatéraux de 16 mètres à 10 mètres. Le chœur fut peut-être restauré, mais nous n’en avons aucune trace parce qu’il fut détruit à la Révolution. Il n’en reste que les soubassements qui ont été dégagés au XIXème siècle. Le pignon de la façade est reconstruit mais mesure 10 mètres de moins que l’original. Le clocher est reconstruit.
Au XIXème siècle l’abbatiale est classée aux Monuments Historiques et bénéficie d’une importante campagne de restauration de 1842 à 1868. Les gravats qui recouvraient les ruines du chœur sont enlevés, quelques maisons sont détruites pour dégager la surface du chevet et la perspective vers la façade occidentale. Les deux entrées latérales de la façade sont débouchées et un large escalier est aménagé devant le parvis en remplacement d’un perron centrale semicirculaire qui avait été aménagé au XVIIème siècle. En 2016 eut lieu le retour des reliques sauvegardées à Toulouse au XVIème siècle et en 2017 la façade a fait l’objet d’une importante campagne de restauration des sculptures.
Compte-tenu de son implantation au centre de l’ancienne ville, totalement entourée de petites maisons presque collées contre les murs restants et malgré les quelques dégagements opérés au XIXème siècle, aucune vue d’ensemble n’est accessible au visiteur, excepté la courte perspective offerte par la petite esplanade devant la façade de l’église. |

En jaune emplacement de l’église actuelle – En bleu emplacement du chœur roman

Vue générale du site (source www.Google-Earth)

Maquette du site actuelle (source www.1090architectes.com)

Vue générale (source www.photo-aerienne-france.fr)

Vue générale (source www.france.jeditoo.com)

Le perron du 17ème siècle (dessin de A. Dauzats-1833)







|
La décoration de la façade est typique de l’art roman provençal dont s’est inspiré l’abbatiale de Saint-Trophime d’Arles. Elle est organisée en trois registres superposés de sculptures, soutenus par des colonnes et chapiteaux inspirés de l’art antique grec et romain. - Le registre inférieur présente un bestiaire issu de l’ancien testament. - Le registre médian présente des personnages du nouveau testament. - La frise supérieur illustre des scènes du nouveau testament. La façade est structurée en trois portails en forme d’arcs de triomphe d’inspiration antique dont les tympans représentent les étapes majeures de la vie du Christ. Le manque d’homogénéité de la façade suggère une construction lente, plusieurs fois interrompue et qui aurait impliquée successivement plusieurs maîtres pour en conduire l’exécution. Des éléments auraient été faits puis défaits et refaits durant les XIIème et XIIIème siècle puis au cours du XVIIème siècle. |

Structure de la façade en trois registres



1-a

1-a

1-b

1-b

1-b



1-c

1-c

1-c

1-c

1-c

1-c

1-c

1-d

1-d

1-d

1-d

1-d

1-d

1-d

1-d

1-e

1-f







2-c


2-d



2-f



b-c

b-c

b-c

c

c

c-d

c-d

c-d

d

d

d-e

d-e
a

a-b

a-b

a-b

e-f

e-f

e

a-b

c-d

e-f




















| Excepté les piliers, la nef est un ouvrage du XVIIème siècle qui ne présente pas d’intérêt au point de vue archéologique. Nous n’en donnons qu’une simple vue d’ensemble. |








Plan en relief du site
|
L’emplacement occupé par le chœur est aussi vaste que celui de la nef actuel, ce qui permet d’imaginer l’ampleur de l’église romane du XIIème siècle. Il n’en reste que les soubassements qui permettent d’imaginer la configuration qu’il avait. |






















|
La "vis de Saint-Gilles" est un escalier en colimaçon dont le voûtement est une merveille de précision et de sophistication dans la stéréotomie. Sa réalisation au début du XIIème siècle est parfaite comme en témoigne la minceur des joints grâce à une parfaite réalisation géométrique des voussoirs. |

|
Elle a été considérée au fil des siècles comme l’exemple parfait de l’art du trait et de la stéréotomie. Elle est prise comme modèle dans les traités de coupe de pierre. |

















|
La crypte, ou église basse, remonte au début du XIème siècle. Longue de 50 mètres et large de 25 mètres, c’es-à-dire les dimensions de la nef actuelle, elle est constituée de trois nefs de six travées. Les trois travées du collatéral nord ont été obstruées sans doute pour supporter l’église haute. La confession où reposait les reliques de Saint Gilles ne fut dégagée qu’au XIXème siècle. Compte tenu de sa longue construction, différentes influences ont contribué : piliers d’inspiration antique, voûte d’arête et voûtes d’ogive. |

Superposition du plan de la crypte et du plan de l’église













|
Dimensions Dimensions initiales Longueur totale : 98 m. Largeur totale : 25 m. Hauteur sous-voûte de la nef centrale : 26 m. Largeur sous-voûte des bas-côté : 16 m.
Dimensions
actuelles
Longueur totale : 50 m. Largeur totale : 25 m. Hauteur sous-voûte de la nef centrale : 15 m. Largeur sous-voûte des bas-côté : 10 m.
Crypte Longueur : 50 m. Largeur : 25 m. |