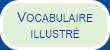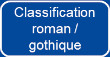




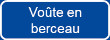






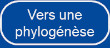




|
Principes Les différents types d’arcs boutants
PRINCIPES |

|
Comme nous l’avons expliqué dans le chapitre L’arc boutant avec le schéma ci-dessus, il s’agit de déporter le point où s’exerce la poussée de la voûte sur une culée située à l’extérieur des collatéraux. Cela revient à déplacer vers l’extérieur de l’édifice l’épais contrefort qu’il aurait fallu dresser contre le mur gouttereau de la nef et qui aurait obstrué le collatéral. Comme le montre le schéma ci-dessous il faut alors placer un étai entre la base de la voûte et la culée, pour transmettre la poussée de la voûte sur la culée. |

|
La largeur des collatéraux des grandes églises nécessitant des arcs boutants pour assurer leur équilibre varie de 4,50 mètres jusqu’à 9,50 mètres pour les édifices munis de doubles collatéraux et peut atteindre 13,50 mètres à la cathédrale de Bourges et même15 mètres à Notre Dame de Paris. Pour une telle traversée de l’espace le seul matériau possible est la pierre d’une part pour sa résistance à la compression et d’autre par sa moindre vulnérabilité aux incendies et aux intempéries. Comme nous l’avons vu dans la fiche Traversée de l’espace avec la pierre, l’arc permet de traverser de larges portées avec des pierres de petites tailles. Il est donc être utilisé pour constitué l’étai en pierre, comme le montre le schéma ci-dessous. |

|
Nous
devons
nous émerveiller du savoir-faire des maîtres d’œuvre
médiévaux. Comme je l’ai déjà dit, ils n’avaient à leur
disposition que la géométrie euclidienne comme approche
théorique et que la règle et le compas comme outil
pratique. Souvent les historiens de l’art évoquent les
tâtonnements ou les hésitations dont ils semblaient
faire preuve. En fait ils expérimentaient de façon
pragmatique par essais-erreurs, non pas au hasard mais
de façon raisonnée. S’ils ne disposaient pas de nos
théories ni de nos outils, ils avaient la même
intelligence que nos architectes et nos ingénieurs. Ils
n’ont cessé d’innover durant tout le Moyen Âge.
Ces quelques mots ci-dessus pour introduire la formidable innovation qu’est l’arc boutant que nous comprenons mieux aujourd’hui grâce aux théories abouties de la statique des solides et de la résistance des matériaux confirmées grâce aux calculs par les méthodes par éléments finis réalisés sur de puissants ordinateurs.
L’astuce
consiste
à disposer l’étai de façon à ce que l’arc prenne appui
dans la zone où s’exerce la poussée latérale de la voûte,
comme l’illustre le
schéma
ci-dessous.
Une autre astuce consiste à
profiler l'étai de façon à ce que la face
supérieur puisse faire office de petit canal pour
écouler les eaux de pluies collectées par les chéneaux
situés à la base de la toiture |

|
La
composante
horizontale
H est ainsi conduite le long des voussoirs de l’arc en
se "verticalisant" progressivement et transmet à la
culée une force horizontale H1 bien plus faible que la
poussée horizontale initiale H. Pour que la culée résiste à l’effet de renversement que produit la force H1 on augmente sa stabilité en augmentant son poids en plaçant à son sommet une masse de pierre de plusieurs tonnes en forme de cône ou de pyramide, généralement très sculptée à partir du XIIIème siècle, appelée pinacle. La culée est ainsi lestée des forces V1 et V2 en plus de son propre poids. |

|
LES DIFFÉRENTS TYPES D’ARCS BOUTANTS Arc-boutant simple à une volée Arc-boutant double à une volée Arc-boutant double à deux volées Les arcs boutants de Notre Dame de Paris
L’application du principe de sauvegarder l’équilibre des édifices sans obstruer les collatéraux grâce à l’emploi d’arcs-boutants a été déclinée selon différentes formules en fonction de la hauteur des édifices et de la présence d’un ou deux collatéraux de part et d’autre de la nef.
Arc-boutant
simple à une volée
|

| Ce
modèle
de base convient pour les édifices à un seul collatéral.
On le trouve dans les églises avec tribunes qui
contrebutent la nef et dont l’étage des fenêtres hautes
n’est pas démesuré, mais aussi les églises sans tribune
dont l’étage des fenêtres hautes reste raisonnable.
Comme par exemple pour Laon, Sens, Mantes la Jolie, édifices avec tribunes ou plus modestes comme pour Rampillon, Laon – Saint Martin, Les Andelys, Noirlac, Saint Martin aux Bois, Sens. |


| Laon – Cathédrale Notre Dame (02) | Sens
– Cathédrale Saint Etienne (89) |


| Mantes-la-Jolie - Collégiale Notre Dame (78) | Rampillon – Église Saint Elphe (77) |


| Laon – Église Saint Martin | Les Andelys – Église Saint Sauveur |


| Abbaye de Noirlac | Saint Martin aux Bois – Abbatiale Saint Martin |


| Sens – Cathédrale Saint Etienne | Auvers sur Oise – Église Notre Dame |

| Arc-boutant double à une volée |

|
Les
maîtres
d’œuvre ont observé qu’avec une certaine hauteur, ce qui
est le cas des cathédrales, les maçonneries étaient
sensibles à l’effet du vent qui pouvait engendrer des
désordres préjudiciables à l’équilibre de
l’édifice. Ces
effets sont d’autant plus important que
l’édifice est
grand et haut. Les calculs que l’on peut faire
aujourd’hui montrent que
pour
un édifice
comme
la cathédrale de Beauvais,
chaque travée est
soumise
à une
force
latérale
de
188 tonnes
par
un vent de 150
kilomètre-heure
Par
simple bon sens les
architectes placèrent
un deuxième étai au dessous du premier, dédoublant ainsi
l’arc-boutant. Ce dispositif fut utilisé pour les
édifices d’une hauteur déjà conséquente et dotés d’un
seul collatéral de part et d’autre de la nef comme, par
exemple, Saint-Denis,
Amiens
pour
la nef, Soisson,
Chartres,
Senlis , Châlons en Champagne.
|


Saint Denis – Cathédrale Saint Denis (coupe par Viollet le Duc)


Amiens – Nef de la cathédrale Notre Dame (coupe par Philippe Gavet)


Soisson – Cathédrale St Gervais & St Protais (coupe par Philippe Gavet)
|
A chartres l’arc boutant supérieur a été ajouté à la fin des travaux, vers 1316, sans doute par précaution. Ils n’étaient pas prévus dans le dessin initial qui était d’une grande pureté.
|


Chartes – Cathédrale Notre Dame (coupe par Philippe Gavet)


| Senlis – Cathédrale Notre Dame | Châlons en Champagne – Cathédrale Saint Pierre |

|
Arc-boutant
double à deux volées
|

| Cette
disposition
se retrouve dans les
très grands édifices munis de deux collatéraux de chaque
côté de la nef. Elle permet de franchir en deux arcs une
large portée. Le principe de l’arc boutant à deux volées et des supports intermédiaires est illustré dans le schéma de principe ci-dessous. |
|
A la cathédrale de Beauvais se posait un défi analogue pour couvrir le déambulatoire et les chapelles rayonnantes, un support intermédiaire fut placé pour recevoir le pied du premier arc et la tête du second. La hardiesse de l’édifice était telle que, lors de la réfection des voûtes qui s’étaient effondrées, les architectes rendirent les culés solidaires les unes des autres grâce à un ensemble de tirants métalliques.
|


Beauvais – Cathédrale Saint Pierre (60)
| A
Bourges les architectes
ne relevèrent pas le défi de parcourir la largeur des deux
collatéraux (13,5 mètres) par un seul arc. Il disposèrent
les
arcs
de façon à ce que la deuxième volée de l’arc inférieur
viennent contrebuter la voûte du collatéral intérieur plus
haute que celle du collatéral extérieur. Les architectes ont utilisé un prinicpe jamais reproduit pour d'autres édifices : des arcs boutants en arc brisé conduisant à une forte inclinaison de l'étai, réduisant ainsi la hauteur de la culée et donc son poids.
|


Bourges – Cathédrales Saint Etienne (18)


Le Mans – Cathédrale Saint Julien




Paris – Cathédrale Notre Dame (75)
| Au
XIIIème
siècle l’édifice fut l’objet d’un profond remaniement, les
fenêtres de la nef furent agrandies, des chenaux furent
installés
pour recueillir les
eaux de pluie et les arcs boutants furent reconstruits
selon une configuration hardie propre à Notre-Dame. La
double volée fut remplacée par un seul arc boutant d’une
portée de 18 mètres. Cette configuration est unique.
|



Paris – Cathédrale Notre Dame (75)